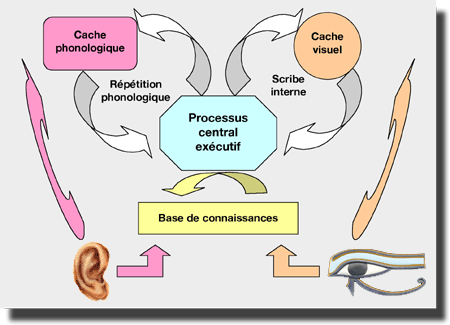Nous avons déjà parlé du premier chapitre de ce livre. Je vais donc continuer avec le second chapitre. Il y fait un rappel des données physiologiques de l'audition, en rappelant la composition de l'oreille. Ce qu'on peut retenir sur la suite est néanmoins qu'il parle de la notion de "contours" (par Deutsch, D., 1977) et de hauteur.
Contours et Hauteurs.
Perretz (1990) aurait identifiée les zones de traitement de ces deux notions musicales: le contours, qui est la perception de la musique globale, de la mélodie, se ferait par l'hémisphère droit et celle des hauteurs (percevoir une note), par l'hémisphère gauche (cunéus et précunéus (aires 18 et 19 de Brodmann), gyrus frontal supérieur (aires 8 et 9) et gyrus temporal supérieur (aire 22). Parfois aussi la région occipitale gauche (de la vision), interprétée comme une représentation imagée de la hauteur sur une échelle de valeur interne).
 | ||
| Courbe de fréquence pour un "Si grave" de Saxophone Ténor. |
Pour la perception à proprement parler, il est intéressant de noter la notion développée de l'isotonie et de la tonotopie. La tonotopie correspond au fait que chaque cil dans l'oreille répond à une fréquence précise, et que selon la disposition des cils entre eux, il va y avoir également une information spatiale qui va pouvoir passer. Par exemple, pour la perception des sons graves, cela se situe dans ce qu'on appelle l'Apex, et pour les sons aigus, dans la base du canal.. Le son passe entre les deux par tous les cils, et si la fréquence du cil est présente dans le son, il va réagir et envoyer au cerveau une information. Le cerveau reçoit donc un ensemble d'informations nerveuses correspondant à la courbe de fréquence de ce qui a été entendu. L'isotonie est le phénomène qui intervient ensuite, une fois que les terminaisons nerveuses des cils sont arrivées au cortex auditif. Le phénomène est similaire: on a pour chaque fréquence un neurone particulier qui est lié au cil.
L'attention musicale
Il existe un phénomène particulier très étudié: le cocktail party effect (Efron, 1983). Le principe est simple: vous êtes dans une soirée, la musique à fond, et tout le monde qui parle autours de vous. Curieusement, dans tout ce brouhaha ambiant, vous arrivez quand même à entretenir une conversation avec celui qui vous interpelle. Comment c'est possible? Par l'intervention de ce qu'on appelle la Cochlée, ou les cellules ciliées externes (les mêmes qui font qu'on entend parfois des sons alors qu'il n'y en a pas), liés directement au pole temporal.
C'est notamment cette capacité que les Chefs d'orchestres doivent développer principalement, afin de discriminer les sons de chaque instrument dans la globalité et même la présence de la moindre fausse note, et qui l'a faite dans l'assemblée.
L'oreille Absolue
Définition: selon Zattore (1989), c'est "la capacité à identifier en dénommant les notes la hauteur d'un grand nombre de sons musicaux et à produire la hauteur exacte d'une note sans recourir à une note de référence.".
L'oreille absolue viendrait d'une zone du lobe temporal postérieur (à l'arrière du crane) et supérieure (au dessus). On appelle cette zone le Planum temporal.
Elle serait présente principalement chez les musiciens qui ont entendu de la musique depuis leur plus jeune âge. Souvent, on pense ce don comme la capacité d'avoir toujours à l'intérieur de soi une sorte de note de référence (par exemple, on sait ce qu'est un LA 3 (440Hz)). C'est le cas pour certains, mais c'est une forme qu'on appelle non pas oreille absolue, mais quasi absolue. Pour l'oreille absolu, il n'y a pas besoin de référence à une note de base par rapport à laquelle on compare celle qu'on entend, on sait directement quelle est la note entendue, sans délai!
Il existe également le phénomène inverse: l'impossibilité d'être juste. On ne peut chanter juste, on ne peut produire un son juste, même si le son à reproduire est entendu en même temps, et on ne peut maintenir la voix, elle va vaciller. On appelle ça un problème "d'ajustement tonal des hauteurs" (Paperman, Vincent et Dumas).
Source: Lechevalier, B. (2006). Le cerveau de Mozart. Odile Jacob: Paris
Source: Lechevalier, B. (2006). Le cerveau de Mozart. Odile Jacob: Paris